NEW YORK – Les présidents, les généraux, les dictateurs et même les gens ordinaires prennent tous les risques lorsqu’ils n’ont plus rien à perdre, tout comme le quarterback du football américain qui, à la dernière minute, joue le tout pour le tout dans une passe désespérée, qu’on nomme dans le jargon du jeu Hail Mary pass. Mais ce type d’action, en politique, à la guerre ou dans les affaires, à généralement des conséquences plus graves qu’à la fin d’un match de football. Au Moyen-Orient, par exemple, c’est bien parce que les parties pensent qu’elles n’ont plus rien à perdre que le conflit n’a jamais cessé.
Le jeu concours boursier qu’organise auprès des étudiants la société de courtage TD Ameritrade offre un bon exemple des incitations conférées par le sentiment de n’avoir rien à perdre. Chaque équipe reçoit une dotation, sur le papier, de 500 000 dollars, et un prix en argent liquide récompense l’équipe dont le portefeuille de titres a généré le plus de profits au bout d’un mois. En 2015, les étudiants de l’université d’État du sud-est du Missouri ont battu les 475 autres équipes concurrentes en transformant leurs 500 000 dollars en 1,3 million de dollars. Aucun des membres de l’équipe gagnante ne connaissait les pratiques de la finance. Comment donc ont-ils pu réaliser une telle plus-value ? Écoutons le capitaine de l’équipe : « Nous n’avions rien à perdre, hormis les 500 000 dollars du jeu. Nous avons simplement décidé de prendre tous les risques. »
Cette stratégie du tout ou rien exploite les règles d’un jeu concours qui ne récompense que les gains et ignore les pertes. Les étudiants ne pouvaient pas réellement perdre cet argent fictif ; ils se sont donc comportés en conséquence. L’anecdote peut sembler triviale, mais la même logique guide souvent les actions des protagonistes dans les conflits « pour de vrai ».
Ainsi l’objectif d’une « capitulation sans conditions » peut-il, en temps de guerre, mener à des conséquences terribles et non souhaitées. Lorsque Franklin Delano Roosevelt, alors président des États-Unis, formula durant la Seconde Guerre mondiale cette exigence qui jouissait d’un large soutien populaire, le ministre nazi de Propagande, Joseph Goebbels put affirmer à Hitler que désormais « les Allemands n’[avaient] plus rien à perdre et tout à gagner » en continuant le combat.
Le général Dwight D. Eisenhower, qui commandait en Europe les forces alliées et serait un jour président des États-Unis donna raison à Goebbels. En novembre 1944, il avertit l’état-major combiné, à Washington, que « la résistance impassible et continue opposée par l’ennemi » provient, en partie, de « la propagande nazie qui persuade à chaque Allemand que la capitulation sans conditions entraînera la destruction complète de l’Allemagne et son élimination en tant que nation ».
Hitler joua sur ce tableau pour motiver ses troupes lors de la contre-offensive désespérée des Ardennes en décembre 1944, prédisant « une bataille de Huns, durant laquelle vous tomberez et mourrez si vous ne tenez pas ». Le coup de dés d’Hitler – sa passe de la dernière chance – ne changea pas l’issue de la guerre, qu’il avait déjà perdue, mais il fut cause des pires atrocités infligées aux troupes américaines en Europe : le massacre de Baugnez, en Belgique.
La même attitude forgée dans la conviction qu’il n’y a rien à perdre nourrit les guerres sans fin entre Israël et la Palestine. En 1973, lorsque la Première ministre israélienne, Golda Meir, rencontra Joe Biden, alors sénateur nouvellement élu du Delaware, pour parler de la sécurité d’Israël, elle lui dit. : « N’ayez pas cet air inquiet […]. Nous autres Israéliens avons une arme secrète. Nous n’avons nulle part ailleurs où aller. »
Plus récemment, Israël pensait aussi n’avoir rien à perdre dans le conflit contre le Hamas, car la charte fondatrice de cette organisation nie à l’État juif le droit d’exister. L’article 11 de cette charte commence ainsi : « Le Mouvement de la Résistance islamique considère que la Palestine est une terre islamique waqf [de mainmorte] pour toutes les générations de musulmans jusqu’au jour de la résurrection. Il est illicite d’y renoncer en tout ou en partie, de s’en séparer en tout ou en partie. » Et l’article 13 ferme définitivement la porte à la paix : « Les initiatives, les prétendues solutions de paix et les conférences internationales préconisées pour régler la question palestinienne vont à l’encontre de la profession de foi du Mouvement de la Résistance islamique. »
Mais Israël doit aussi tenir compte des Palestiniens qui veulent d’abord un État à eux, plutôt que la destruction d’Israël. Comme l’écrit Riyad Mansour, observateur de la Palestine aux Nations Unies, en réaction au dernier conflit avec la bande de Gaza au mois de mai dernier, Israël « n’est pas parvenu à vaincre la conscience palestinienne ni à détruire [le] sentiment national […]. Nous sommes tous à la croisée des chemins ».
Au même moment, Tzipi Livni, ancienne Vice-Première ministre et ancienne ministre de la Justice israélienne, écrivait : « La solution à deux États […] semble toujours d’actualité. Même si la paix n’est pas directement en vue, le point de non-retour est plus proche qu’il ne l’a jamais été. Nous ne devons pas aller jusque-là. La chose la plus importante pour le moment est de maintenir la route ouverte. »
En d’autres termes : gardons-nous des ennemis qui n’ont rien à perdre.
Martin Luther King, un peu plus d’un an avant qu’il ne soit assassiné à Memphis, reprenait une idée similaire pour éviter une révolution armée :
« Les émeutes sont le fruit de situations intolérables. Les révoltes violentes sont
provoquées par des situations révoltantes, et rien n’est plus dangereux que de construire une société dont une grande part de la population a le sentiment de ne pas y avoir sa place, de n’avoir rien à perdre. »
Dans un monde qu’accablent les conflits à somme nulle, anciens et nouveaux, la leçon est plus que jamais pertinente.
Traduit de l’anglais par François Boisivon





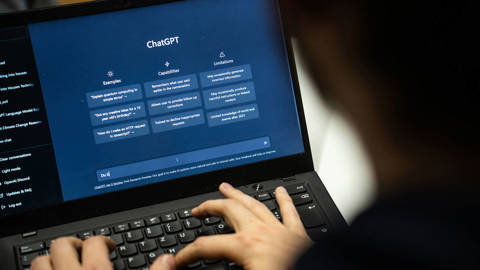






NEW YORK – Les présidents, les généraux, les dictateurs et même les gens ordinaires prennent tous les risques lorsqu’ils n’ont plus rien à perdre, tout comme le quarterback du football américain qui, à la dernière minute, joue le tout pour le tout dans une passe désespérée, qu’on nomme dans le jargon du jeu Hail Mary pass. Mais ce type d’action, en politique, à la guerre ou dans les affaires, à généralement des conséquences plus graves qu’à la fin d’un match de football. Au Moyen-Orient, par exemple, c’est bien parce que les parties pensent qu’elles n’ont plus rien à perdre que le conflit n’a jamais cessé.
Le jeu concours boursier qu’organise auprès des étudiants la société de courtage TD Ameritrade offre un bon exemple des incitations conférées par le sentiment de n’avoir rien à perdre. Chaque équipe reçoit une dotation, sur le papier, de 500 000 dollars, et un prix en argent liquide récompense l’équipe dont le portefeuille de titres a généré le plus de profits au bout d’un mois. En 2015, les étudiants de l’université d’État du sud-est du Missouri ont battu les 475 autres équipes concurrentes en transformant leurs 500 000 dollars en 1,3 million de dollars. Aucun des membres de l’équipe gagnante ne connaissait les pratiques de la finance. Comment donc ont-ils pu réaliser une telle plus-value ? Écoutons le capitaine de l’équipe : « Nous n’avions rien à perdre, hormis les 500 000 dollars du jeu. Nous avons simplement décidé de prendre tous les risques. »
Cette stratégie du tout ou rien exploite les règles d’un jeu concours qui ne récompense que les gains et ignore les pertes. Les étudiants ne pouvaient pas réellement perdre cet argent fictif ; ils se sont donc comportés en conséquence. L’anecdote peut sembler triviale, mais la même logique guide souvent les actions des protagonistes dans les conflits « pour de vrai ».
Ainsi l’objectif d’une « capitulation sans conditions » peut-il, en temps de guerre, mener à des conséquences terribles et non souhaitées. Lorsque Franklin Delano Roosevelt, alors président des États-Unis, formula durant la Seconde Guerre mondiale cette exigence qui jouissait d’un large soutien populaire, le ministre nazi de Propagande, Joseph Goebbels put affirmer à Hitler que désormais « les Allemands n’[avaient] plus rien à perdre et tout à gagner » en continuant le combat.
Le général Dwight D. Eisenhower, qui commandait en Europe les forces alliées et serait un jour président des États-Unis donna raison à Goebbels. En novembre 1944, il avertit l’état-major combiné, à Washington, que « la résistance impassible et continue opposée par l’ennemi » provient, en partie, de « la propagande nazie qui persuade à chaque Allemand que la capitulation sans conditions entraînera la destruction complète de l’Allemagne et son élimination en tant que nation ».
Hitler joua sur ce tableau pour motiver ses troupes lors de la contre-offensive désespérée des Ardennes en décembre 1944, prédisant « une bataille de Huns, durant laquelle vous tomberez et mourrez si vous ne tenez pas ». Le coup de dés d’Hitler – sa passe de la dernière chance – ne changea pas l’issue de la guerre, qu’il avait déjà perdue, mais il fut cause des pires atrocités infligées aux troupes américaines en Europe : le massacre de Baugnez, en Belgique.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
La même attitude forgée dans la conviction qu’il n’y a rien à perdre nourrit les guerres sans fin entre Israël et la Palestine. En 1973, lorsque la Première ministre israélienne, Golda Meir, rencontra Joe Biden, alors sénateur nouvellement élu du Delaware, pour parler de la sécurité d’Israël, elle lui dit. : « N’ayez pas cet air inquiet […]. Nous autres Israéliens avons une arme secrète. Nous n’avons nulle part ailleurs où aller. »
Plus récemment, Israël pensait aussi n’avoir rien à perdre dans le conflit contre le Hamas, car la charte fondatrice de cette organisation nie à l’État juif le droit d’exister. L’article 11 de cette charte commence ainsi : « Le Mouvement de la Résistance islamique considère que la Palestine est une terre islamique waqf [de mainmorte] pour toutes les générations de musulmans jusqu’au jour de la résurrection. Il est illicite d’y renoncer en tout ou en partie, de s’en séparer en tout ou en partie. » Et l’article 13 ferme définitivement la porte à la paix : « Les initiatives, les prétendues solutions de paix et les conférences internationales préconisées pour régler la question palestinienne vont à l’encontre de la profession de foi du Mouvement de la Résistance islamique. »
Mais Israël doit aussi tenir compte des Palestiniens qui veulent d’abord un État à eux, plutôt que la destruction d’Israël. Comme l’écrit Riyad Mansour, observateur de la Palestine aux Nations Unies, en réaction au dernier conflit avec la bande de Gaza au mois de mai dernier, Israël « n’est pas parvenu à vaincre la conscience palestinienne ni à détruire [le] sentiment national […]. Nous sommes tous à la croisée des chemins ».
Au même moment, Tzipi Livni, ancienne Vice-Première ministre et ancienne ministre de la Justice israélienne, écrivait : « La solution à deux États […] semble toujours d’actualité. Même si la paix n’est pas directement en vue, le point de non-retour est plus proche qu’il ne l’a jamais été. Nous ne devons pas aller jusque-là. La chose la plus importante pour le moment est de maintenir la route ouverte. »
En d’autres termes : gardons-nous des ennemis qui n’ont rien à perdre.
Martin Luther King, un peu plus d’un an avant qu’il ne soit assassiné à Memphis, reprenait une idée similaire pour éviter une révolution armée :
« Les émeutes sont le fruit de situations intolérables. Les révoltes violentes sont provoquées par des situations révoltantes, et rien n’est plus dangereux que de construire une société dont une grande part de la population a le sentiment de ne pas y avoir sa place, de n’avoir rien à perdre. »
Dans un monde qu’accablent les conflits à somme nulle, anciens et nouveaux, la leçon est plus que jamais pertinente.
Traduit de l’anglais par François Boisivon