LONDRES – Lorsqu’on lui a demandé s’il appuierait un cessez-le-feu après l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas, le président des États-Unis, Joe Biden, a répondu qu’il s’entretiendrait avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, « dans une heure, et je [pourrais] vous parler après cela ». Il ne s’agit pas là d’une des gaffes de Biden. L’apparente déférence que marque le président à l’égard de Nétanyahou soulève d’alarmantes questions – quoiqu’elles ne soient pas nouvelles – sur la nature de la relation entre les États-Unis et Israël.
Israël est ce que les spécialistes des relations internationales nomment dans leur jargon « la queue qui secoue le chien ». Étant donné la dissymétrie de puissance entre les deux États, on pourrait s’attendre à ce que les États-Unis, en tant que superpuissance qui fournit à Israël 8,3 milliards de dollars d’aide militaire annuelle, fixent les règles fondamentales de leurs relations. Dans le cas d’Israël, c’est pourtant l’inverse qui est vrai.
Depuis les années 1980, prévaut dans les milieux de la politique étrangère aux États-Unis un consensus : Israël est mieux à même de juger comment préserver sa sécurité, et c’est un soutien sans ambiguïté, dénué de pressions, qui le poussera à prendre les risques nécessaires à la paix. Par conséquent, les présidents des États-Unis s’en remettent souvent à leurs homologues israéliens lorsqu’il s’agit de la guerre ou de la paix au Moyen-Orient, quand bien même des intérêts vitaux américains sont en jeu. Pourtant, loin de donner aux États-Unis une influence sur Israël ou de faire progresser les perspectives de paix, cette approche de la relation bilatérale s’est avérée préjudiciable aux deux pays.
Nétanyahou ne sait que trop bien comment peser sur la vie politique américaine, surtout lorsqu’éclate un conflit ouvert. Depuis longtemps, il utilise l’affirmation réitérée par les États-Unis du « droit d’Israël à se défendre », sans prendre en considération la responsabilité des dirigeants israéliens dans le déclenchement des crises. Cette fois encore, les autorités américaines, les deux partis confondus, ont tenté d’éviter de reconnaître le rôle direct qu’a joué Nétanyahou dans le sabotage de la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens en privant de leurs droits les citoyens palestiniens d’Israël et en renforçant le poids des courants les plus extrémistes et xénophobes du pays.
Biden connaît bien Nétanyahou, pour l’avoir rencontré lorsqu’il était sénateur, puis vice-président durant les huit années de l’administration Obama. En 2011, Nétanyahou avait publiquement humilié le premier président noir de l’Amérique, l’ancien patron de Joe Biden, en lui donnant dans le Bureau ovale une sorte de cours privé sur la politique des États-Unis et la sécurité d’Israël… diffusé en direct à la télévision américaine. Pis, il s’était entendu quelque temps plus tard avec les républicains du Congrès pour tenter de torpiller l’accord de 2015 sur le nucléaire avec l’Iran.
En faisant trop peu de cas du long passé d’agitateur de Nétanyahou, la position de Biden dans le conflit actuel équivaut à donner le feu vert à Israël pour qu’il poursuive sa campagne militaire contre le Hamas. Trois fois déjà depuis le début du conflit, les États-Unis ont bloqué des déclarations du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelaient à un cessez-le-feu immédiat, conduisant les diplomates onusiens à la conclusion que l’administration Biden souhaitait en cette matière que l’organisation demeure « silencieuse ».
En outre, le 17 mai, tandis que la violence à Gaza s’intensifiait, le Washington Postrapportait que Biden avait approuvé la vente à Israël d’armes à guidage de précision pour une valeur de 735 millions de dollars, tirant ainsi la sonnette d’alarme pour les démocrates de la Chambre des représentants qui appelaient l’administration à encourager un cessez-le-feu et à s’attacher aux causes profondes du conflit. Pour des raisons évidentes, l’escalade de cet épisode sanglant aura des conséquences profondes, non seulement pour les populations civiles à Gaza, mais aussi, d’une façon plus générale, pour la paix et la sécurité dans la région.
Le lendemain, après des pressions croissantes, venant des États-Unis comme de l’étranger, et après avoir parlé avec Nétanyahou, Biden a exprimé son soutien à un cessez-le-feu. Mais Nétanyahou a fait clairement savoir qu’il n’était pas prêt à interrompre les frappes aériennes sur Gaza, et la Maison Blanche demeure semble-t-il réticente à la persuader du contraire tant que le Hamas continuera à tirer sans discrimination ses roquettes sur Israël.
Biden appartient sans conteste à cette génération de responsables politiques qui, aux États-Unis, s’accroche à la vision quelque peu vieillie d’un État d’Israël incarnant une démocratie pleine de promesses dans un océan d’autocratie arabe et musulmane. Biden et les dirigeants – démocrates ou républicains – qui pensent comme lui se montrent volontiers oublieux des témoignages de violences systémiques et de crimes commis par les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et en Israël même. De récents rapports, produits par le principal groupe israélien de défense des droits humains, B’Tselem, et par Human Rights Watch exposent des arguments convaincants pour affirmer qu’Israël n’est plus aujourd’hui une démocratie, mais bel et bien un état d’« apartheid ».
Certaines voix, et non des moindres, se font pourtant entendre dans le parti démocrate, qui remettent en question l’hégémonie pro-israélienne y prévalant jusque-là, et le paysage politique aux États-Unis commence à évoluer. On peut douter que Biden aurait utilisé le mot « cessez-le-feu » sans la déclaration conjointe de vingt-neuf sénateurs démocrates appelant à ce que celui-ci entre « immédiatement » en vigueur. Parmi les responsables à l’initiative de ce mouvement, qui prend de l’ampleur, figure le sénateur Bernie Sanders, dont l’influence est incontestable sur une part importante de la base du parti démocrate.
Il est aussi encourageant de constater que les juifs américains se montrent de plus en plus sceptiques à l’égard de Nétanyahou. D’après une récente enquête du Pew Research Center, seuls 34 % d’entre eux affirment être fermement opposés à des sanctions ou à des mesures de rétorsion contre Israël. Contrairement à ce que voudrait faire croire à l’Amérique le lobby animé par le Likoud, les juifs américains ne sont pas un monolithe. Les jeunes juifs américains, notamment, sont souvent très critiques envers les politiques coloniales et martiales d’Israël.
Malgré les voix nouvelles qui s’élèvent dans le parti démocrate et dans la communauté juive américaine, il faudra probablement une génération pour que l’évolution des cercles de la politique étrangère aux États-Unis ramène le balancier au centre sur ce qui concerne Israël et la Palestine. En attendant, la queue continuera de remuer le chien. Cette situation éloigne encore une paix durable, viable et juste en Terre sainte et sape les intérêts des États-Unis dans l’ensemble du Moyen-Orient.
Traduit de l’anglais par François Boisivon





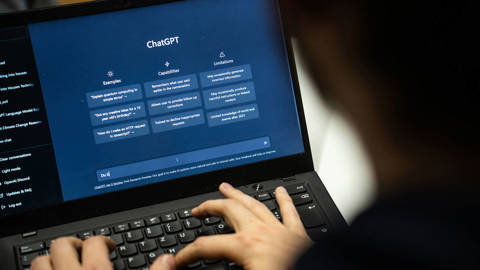






LONDRES – Lorsqu’on lui a demandé s’il appuierait un cessez-le-feu après l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas, le président des États-Unis, Joe Biden, a répondu qu’il s’entretiendrait avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, « dans une heure, et je [pourrais] vous parler après cela ». Il ne s’agit pas là d’une des gaffes de Biden. L’apparente déférence que marque le président à l’égard de Nétanyahou soulève d’alarmantes questions – quoiqu’elles ne soient pas nouvelles – sur la nature de la relation entre les États-Unis et Israël.
Israël est ce que les spécialistes des relations internationales nomment dans leur jargon « la queue qui secoue le chien ». Étant donné la dissymétrie de puissance entre les deux États, on pourrait s’attendre à ce que les États-Unis, en tant que superpuissance qui fournit à Israël 8,3 milliards de dollars d’aide militaire annuelle, fixent les règles fondamentales de leurs relations. Dans le cas d’Israël, c’est pourtant l’inverse qui est vrai.
Depuis les années 1980, prévaut dans les milieux de la politique étrangère aux États-Unis un consensus : Israël est mieux à même de juger comment préserver sa sécurité, et c’est un soutien sans ambiguïté, dénué de pressions, qui le poussera à prendre les risques nécessaires à la paix. Par conséquent, les présidents des États-Unis s’en remettent souvent à leurs homologues israéliens lorsqu’il s’agit de la guerre ou de la paix au Moyen-Orient, quand bien même des intérêts vitaux américains sont en jeu. Pourtant, loin de donner aux États-Unis une influence sur Israël ou de faire progresser les perspectives de paix, cette approche de la relation bilatérale s’est avérée préjudiciable aux deux pays.
Nétanyahou ne sait que trop bien comment peser sur la vie politique américaine, surtout lorsqu’éclate un conflit ouvert. Depuis longtemps, il utilise l’affirmation réitérée par les États-Unis du « droit d’Israël à se défendre », sans prendre en considération la responsabilité des dirigeants israéliens dans le déclenchement des crises. Cette fois encore, les autorités américaines, les deux partis confondus, ont tenté d’éviter de reconnaître le rôle direct qu’a joué Nétanyahou dans le sabotage de la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens en privant de leurs droits les citoyens palestiniens d’Israël et en renforçant le poids des courants les plus extrémistes et xénophobes du pays.
Biden connaît bien Nétanyahou, pour l’avoir rencontré lorsqu’il était sénateur, puis vice-président durant les huit années de l’administration Obama. En 2011, Nétanyahou avait publiquement humilié le premier président noir de l’Amérique, l’ancien patron de Joe Biden, en lui donnant dans le Bureau ovale une sorte de cours privé sur la politique des États-Unis et la sécurité d’Israël… diffusé en direct à la télévision américaine. Pis, il s’était entendu quelque temps plus tard avec les républicains du Congrès pour tenter de torpiller l’accord de 2015 sur le nucléaire avec l’Iran.
En faisant trop peu de cas du long passé d’agitateur de Nétanyahou, la position de Biden dans le conflit actuel équivaut à donner le feu vert à Israël pour qu’il poursuive sa campagne militaire contre le Hamas. Trois fois déjà depuis le début du conflit, les États-Unis ont bloqué des déclarations du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelaient à un cessez-le-feu immédiat, conduisant les diplomates onusiens à la conclusion que l’administration Biden souhaitait en cette matière que l’organisation demeure « silencieuse ».
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
En outre, le 17 mai, tandis que la violence à Gaza s’intensifiait, le Washington Postrapportait que Biden avait approuvé la vente à Israël d’armes à guidage de précision pour une valeur de 735 millions de dollars, tirant ainsi la sonnette d’alarme pour les démocrates de la Chambre des représentants qui appelaient l’administration à encourager un cessez-le-feu et à s’attacher aux causes profondes du conflit. Pour des raisons évidentes, l’escalade de cet épisode sanglant aura des conséquences profondes, non seulement pour les populations civiles à Gaza, mais aussi, d’une façon plus générale, pour la paix et la sécurité dans la région.
Le lendemain, après des pressions croissantes, venant des États-Unis comme de l’étranger, et après avoir parlé avec Nétanyahou, Biden a exprimé son soutien à un cessez-le-feu. Mais Nétanyahou a fait clairement savoir qu’il n’était pas prêt à interrompre les frappes aériennes sur Gaza, et la Maison Blanche demeure semble-t-il réticente à la persuader du contraire tant que le Hamas continuera à tirer sans discrimination ses roquettes sur Israël.
Biden appartient sans conteste à cette génération de responsables politiques qui, aux États-Unis, s’accroche à la vision quelque peu vieillie d’un État d’Israël incarnant une démocratie pleine de promesses dans un océan d’autocratie arabe et musulmane. Biden et les dirigeants – démocrates ou républicains – qui pensent comme lui se montrent volontiers oublieux des témoignages de violences systémiques et de crimes commis par les autorités israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et en Israël même. De récents rapports, produits par le principal groupe israélien de défense des droits humains, B’Tselem, et par Human Rights Watch exposent des arguments convaincants pour affirmer qu’Israël n’est plus aujourd’hui une démocratie, mais bel et bien un état d’« apartheid ».
Certaines voix, et non des moindres, se font pourtant entendre dans le parti démocrate, qui remettent en question l’hégémonie pro-israélienne y prévalant jusque-là, et le paysage politique aux États-Unis commence à évoluer. On peut douter que Biden aurait utilisé le mot « cessez-le-feu » sans la déclaration conjointe de vingt-neuf sénateurs démocrates appelant à ce que celui-ci entre « immédiatement » en vigueur. Parmi les responsables à l’initiative de ce mouvement, qui prend de l’ampleur, figure le sénateur Bernie Sanders, dont l’influence est incontestable sur une part importante de la base du parti démocrate.
Il est aussi encourageant de constater que les juifs américains se montrent de plus en plus sceptiques à l’égard de Nétanyahou. D’après une récente enquête du Pew Research Center, seuls 34 % d’entre eux affirment être fermement opposés à des sanctions ou à des mesures de rétorsion contre Israël. Contrairement à ce que voudrait faire croire à l’Amérique le lobby animé par le Likoud, les juifs américains ne sont pas un monolithe. Les jeunes juifs américains, notamment, sont souvent très critiques envers les politiques coloniales et martiales d’Israël.
Malgré les voix nouvelles qui s’élèvent dans le parti démocrate et dans la communauté juive américaine, il faudra probablement une génération pour que l’évolution des cercles de la politique étrangère aux États-Unis ramène le balancier au centre sur ce qui concerne Israël et la Palestine. En attendant, la queue continuera de remuer le chien. Cette situation éloigne encore une paix durable, viable et juste en Terre sainte et sape les intérêts des États-Unis dans l’ensemble du Moyen-Orient.
Traduit de l’anglais par François Boisivon